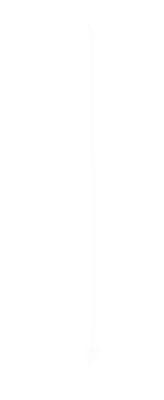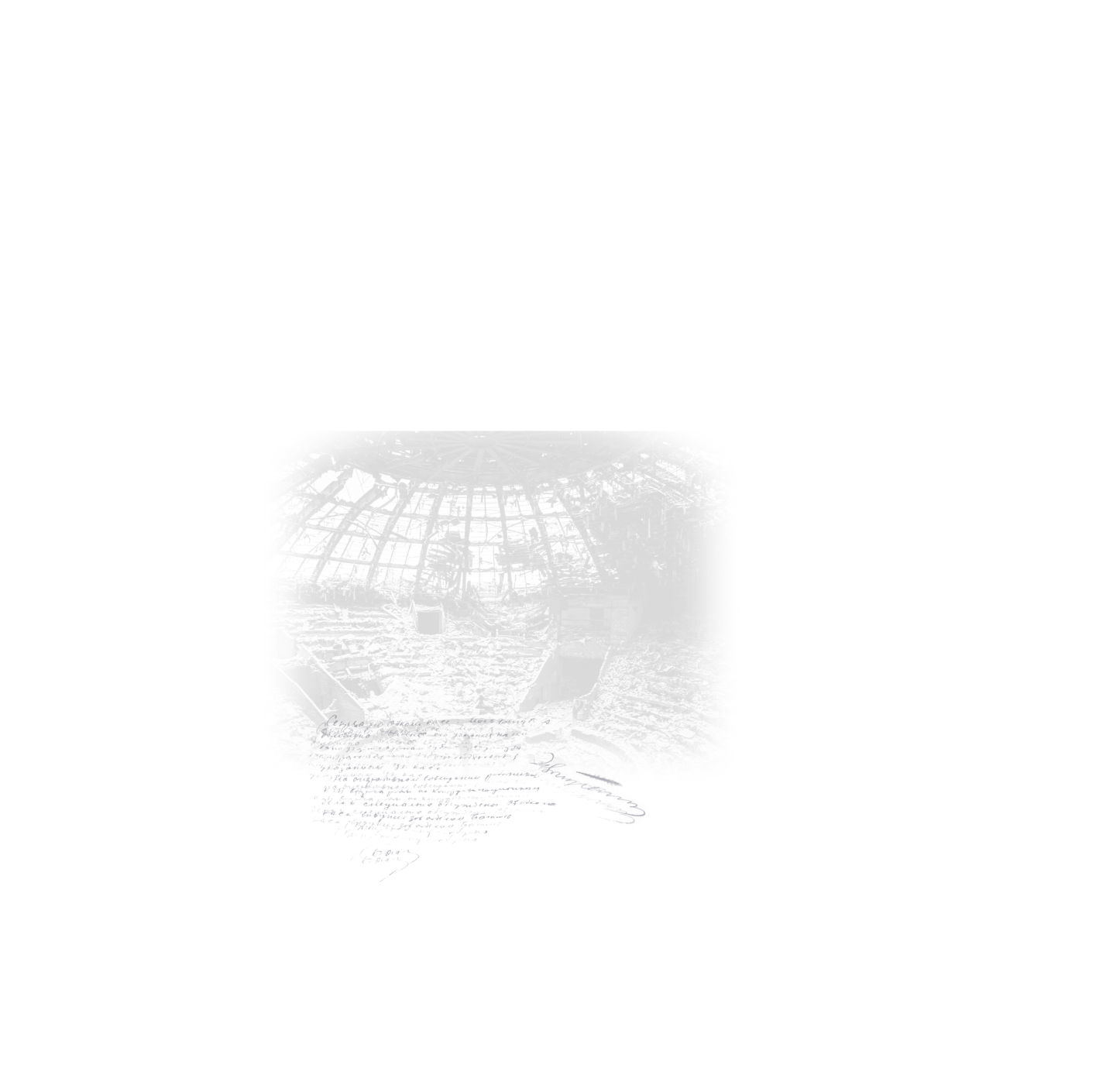
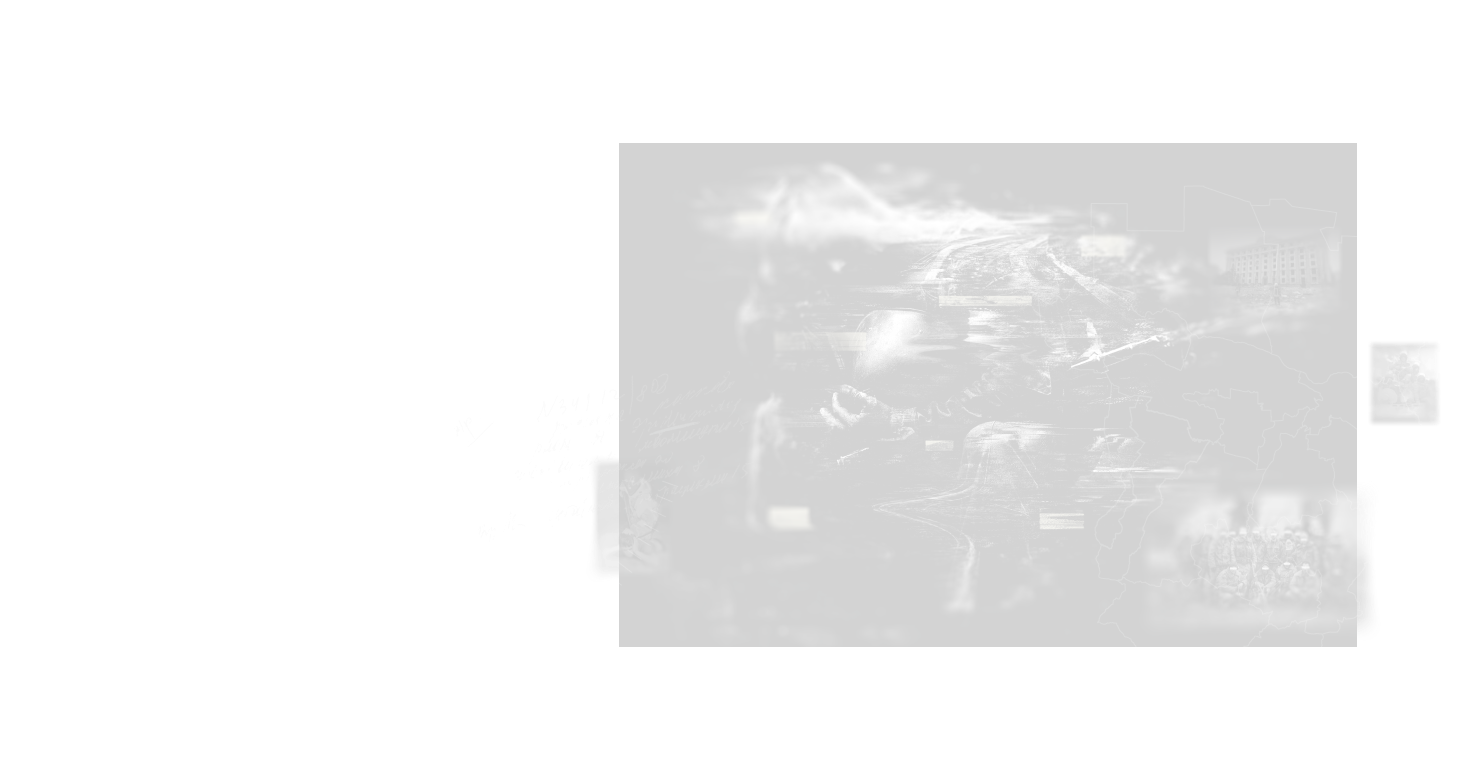
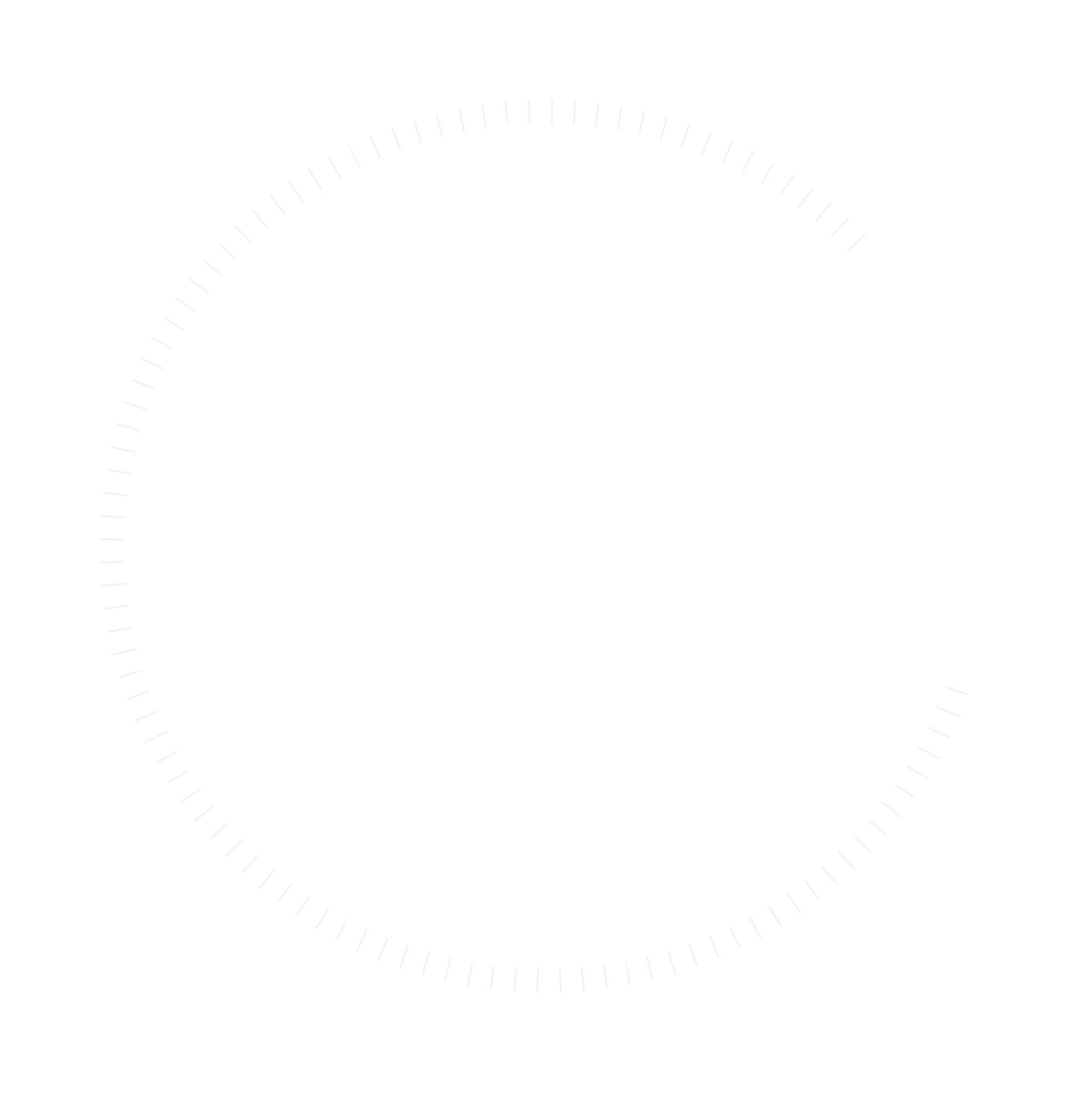
« On se balance de tout le monde »
comment les réfugiés politiques et LGBT venus chercher protection en Russie sont abandonnés à leur sort
Voilà des années que de nombreuses personnes originaires d’Asie centrale et d’Afrique viennent chercher refuge en Russie dans l’espoir d’échapper à la répression politique et aux persécutions liées à leur orientation sexuelle. À leurs yeux, la Russie, c’est « presque l’Europe » : un grand pays où il est facile de se fondre dans la population et de vivre sans subir la pression de l’État. Mais dans les faits, ces nouveaux arrivants sont confrontés à la xénophobie, qui met leur vie en danger, à l’impossibilité de régulariser leur situation et à la peur constante d’être expulsés. Dans son enquête « Les étrangers », menée dans le cadre du projet « Trente ans avant » du CDDH Memorial, le média en ligne Cherta raconte l’histoire des migrants politiques et LGBT en Russie, et explique pourquoi ils sont encore plus en danger depuis le déclenchement de l'invasion à grande ampleur de l'Ukraine en février 2022.
En 2007, Marco (le prénom a été modifié), un habitant de Tachkent âgé de 25 ans, a été renvoyé de son université, alors qu’il n’était qu’à un an d’obtenir son diplôme. Il a par conséquent été expulsé de la résidence étudiante où il vivait. Il aurait pu retourner dans sa ville natale auprès de sa mère, qui s’était endettée pour payer ses études, mais cette idée lui faisait honte. Dès lors, il ne lui restait plus qu’à dormir épisodiquement chez diverses connaissances qui acceptaient de l’accueillir et, de plus en plus souvent, dans la rue.
« Le jour où j’ai été exclus de l’université a été une tragédie pour moi. J’ai littéralement tout perdu et j’ai compris que je n’étais rien ni personne dans ce pays, que je n’y bénéficiais d’aucune protection », confie Marco à Cherta. Ce sentiment d’isolement et d’abandon n’était pas dû uniquement à son exclusion de l’université.
Marco s’est rendu compte dès l’enfance qu’il était homosexuel. Il lui était difficile de le dissimuler : il s’est toujours comporté de manière assez maniérée et son orientation sexuelle « sautait aux yeux ». Or en Ouzbékistan l’homosexualité est illégale : l’article 120 du code pénal la punit d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. À onze ans, Marco a été violé par un voisin. Il ne l’a pas dit à ses parents, de peur qu’ils le tuent. Pour la même raison, il n’est pas allé voir la police, ni la première fois, ni les suivantes, car ce viol s’est reproduit à de multiples reprises.
Marco affirme que depuis son adolescence, des hommes adultes l’ont régulièrement contraint à avoir des relations sexuelles avec eux. C’est d’ailleurs pour avoir refusé d’avoir une fois de plus des relations sexuelles avec l’un de ses professeurs qu’il a été renvoyé de son université.
« Je ne voulais plus vivre. Mais j’ai entendu quelque part le mot "Russie" et j’ai repris espoir, - raconte Marco. - Mon père a de la famille à Kemerovo, et quand j’étais petit, nous avons vécu chez eux pendant un certain temps. Quand un jour à Tachkent j’ai entendu parler de la Russie, cela m’a donné la force de vivre. »
Quelques mois plus tard, Marco a avoué à sa mère qu’il avait été exclu de l’université et lui a demandé cent dollars pour pouvoir aller s’installer en Russie. Il a pris un bus et quitté l’Ouzbékistan. Il pensait être en route vers l’espoir ; en réalité, il était en route vers l’une des pires déceptions de sa vie.
« Le jour où j’ai été exclus de l’université a été une tragédie pour moi. J’ai littéralement tout perdu et j’ai compris que je n’étais rien ni personne dans ce pays, que je n’y bénéficiais d’aucune protection », confie Marco à Cherta. Ce sentiment d’isolement et d’abandon n’était pas dû uniquement à son exclusion de l’université.
Marco s’est rendu compte dès l’enfance qu’il était homosexuel. Il lui était difficile de le dissimuler : il s’est toujours comporté de manière assez maniérée et son orientation sexuelle « sautait aux yeux ». Or en Ouzbékistan l’homosexualité est illégale : l’article 120 du code pénal la punit d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. À onze ans, Marco a été violé par un voisin. Il ne l’a pas dit à ses parents, de peur qu’ils le tuent. Pour la même raison, il n’est pas allé voir la police, ni la première fois, ni les suivantes, car ce viol s’est reproduit à de multiples reprises.
Marco affirme que depuis son adolescence, des hommes adultes l’ont régulièrement contraint à avoir des relations sexuelles avec eux. C’est d’ailleurs pour avoir refusé d’avoir une fois de plus des relations sexuelles avec l’un de ses professeurs qu’il a été renvoyé de son université.
« Je ne voulais plus vivre. Mais j’ai entendu quelque part le mot "Russie" et j’ai repris espoir, - raconte Marco. - Mon père a de la famille à Kemerovo, et quand j’étais petit, nous avons vécu chez eux pendant un certain temps. Quand un jour à Tachkent j’ai entendu parler de la Russie, cela m’a donné la force de vivre. »
Quelques mois plus tard, Marco a avoué à sa mère qu’il avait été exclu de l’université et lui a demandé cent dollars pour pouvoir aller s’installer en Russie. Il a pris un bus et quitté l’Ouzbékistan. Il pensait être en route vers l’espoir ; en réalité, il était en route vers l’une des pires déceptions de sa vie.
« J’ai entendu le mot "Russie" et j’ai repris espoir »
Disclaimer:
Cet article a été écrit dans le cadre du projet « 30 ans avant » du Centre des droits humains Memorial. Les opinions de la rédaction et celles du Centre des droits humains Memorial peuvent diverger.
2 Avril 2024
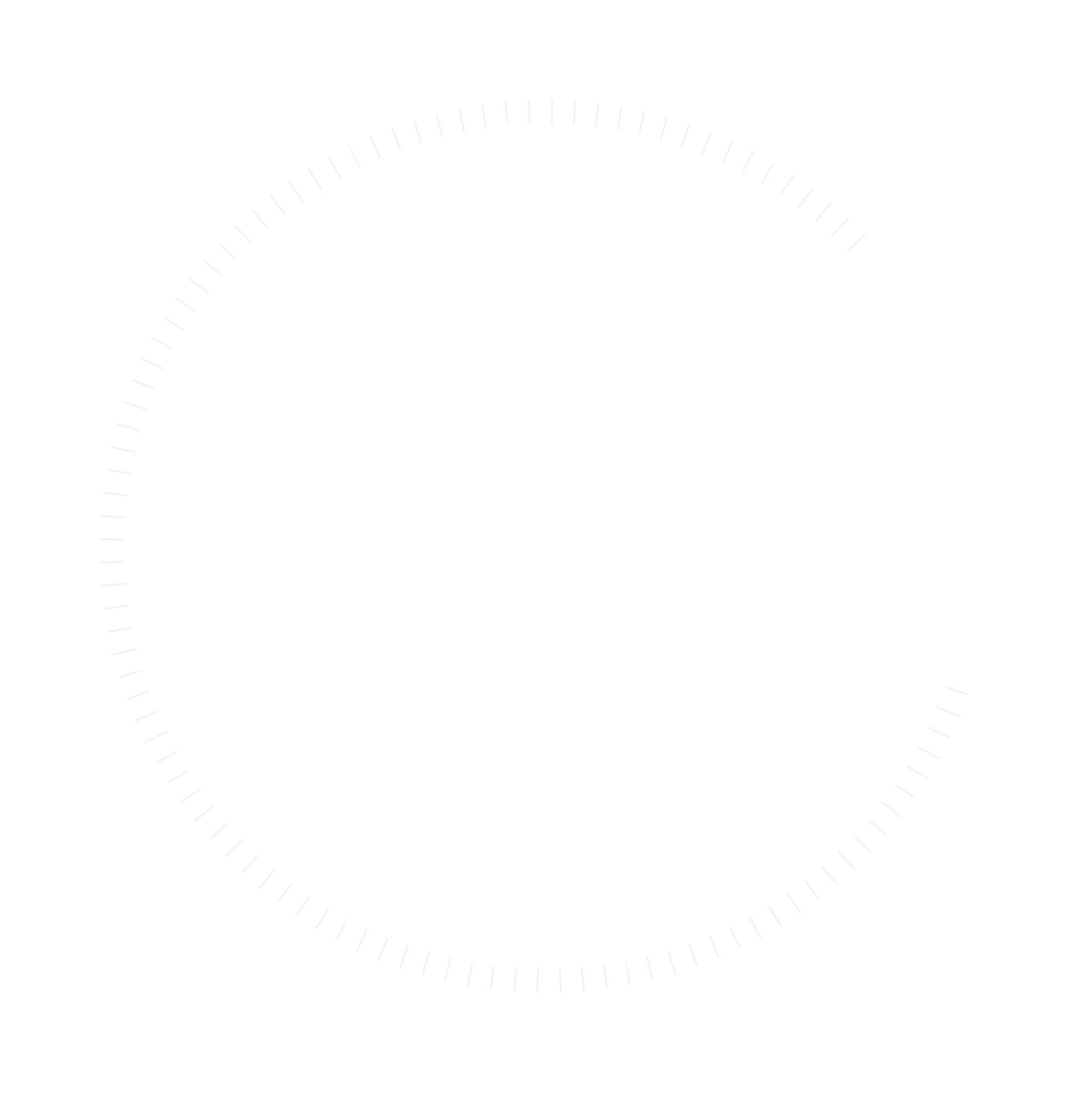
Marco est loin d’être le seul à avoir fui l’Ouzbékistan en raison de l’homophobie et de la violence qui y règnent. Les droits des personnes LGBT sont régulièrement bafoués dans le pays. Aujourd’hui, l’homosexualité est considérée comme un crime dans deux des cinq républiques d’Asie centrale : au Turkménistan et en Ouzbékistan. Mais selon Nadejda Ataeva, présidente de l’association Droits de l’homme en Asie centrale, c’est avant tout en Ouzbékistan que la violence sexualisée et l’homophobie sont utilisées comme outil de pression sur les personnes indésirables pour l’État.
« En prison, le viol est employé comme une forme de torture à l’encontre des détenus politiques », explique-t-elle. « Après avoir subi un viol, ces hommes sont considérés comme des parias de la société. Leurs enfants ne pourront pas se marier : la makhalla (la communauté locale et ses représentants) ne viendra pas au mariage et ne soutiendra pas leur famille. »
Selon la militante des droits humains, les personnes LGBT victimes de violences sexuelles ne peuvent bénéficier d’aucune protection en Ouzbékistan, du fait de l’existence de l’article du code pénal criminalisant l’homosexualité et de l’homophobie ordinaire de la société ouzbèque. Et quand un membre de leur famille découvre ce qui leur est arrivé, ce sont les victimes qui sont considérées responsables des violences qu’elles ont subies.
D’après les informations récoltées par le Centre anti-discrimination Memorial, c'est au Turkménistan que des peines de prison pour homosexualité sont le plus souvent prononcées. En outre, les personnes condamnées pour cela sont souvent condamnées de nouveau, après leur libération, pour récidive. Derrière les barreaux, elles subissent des tortures et des violences sexuelles. À leur sortie de prison, elles n’ont pratiquement aucune chance de trouver un emploi normal et de s’adapter à la vie en société.
Les personnes LGBT ont peur de vivre dans un environnement aussi agressif et intolérant, et sont nombreuses à chercher un moyen de quitter le pays. Ataeva explique que plusieurs critères déterminent leur choix du pays de destination : la possibilité de s’y rendre sans visa, la maîtrise de la langue qui y est parlée et l’opportunité d’en partir ensuite vers un pays tiers, par exemple les États-Unis. C’est pourquoi les ressortissants d’Asie centrale partent dans leur très grande majorité en Russie, en Géorgie ou en Turquie – et avant la guerre, en Ukraine. La plupart de ceux qui choisissent la Russie comptent sur la taille immense du pays, croyant qu’ils pourront y vivre et y travailler sans qu’on les remarque particulièrement. Mais hélas pour eux, cette vision des choses est erronée.
Lorsque Marco est arrivé en Russie, il a senti qu’il pouvait se comporter plus librement : il s’est mis à prendre encore plus soin de lui et a acheté des jeans plus serrés que ceux qu’il pouvait se permettre de porter en Ouzbékistan. Il est tombé amoureux pour la première fois et a commencé à fréquenter un jeune homme. Au début, il a travaillé comme figurant dans des émissions télévisées et a dormi avec d’autres migrants dans des trains, des entrées d’immeuble et des sous-sols. Pendant cette période, il a été battu à plusieurs reprises par des adolescents et des jeunes hommes, qu’il décrit comme des skinheads. Un jour, rapporte-t-il, ses agresseurs l’ont emmené dans une forêt, l’ont frappé et lui ont uriné dessus.
« En Russie, j’ai ressenti le racisme chaque jour sans exception », dit Marco. « J’entre dans un magasin et j’entends des commentaires classiques du type : "Qu’est-ce qu’ils viennent foutre chez nous?", puis "Oh, voyez comme il est apprêté, comme il est parfumé. C’est peut-être un homosexuel ? Il n’avait probablement même pas de peigne dans son Tchourkistan [dénomination dégradante employée pour désigner les pays d’Asie centrale]". Et encore, ça, ce n’était pas grand-chose. Parfois, ils me frappaient. »
La goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Marco fut un incident survenu en 2012. À l’époque, il vivait à Obninsk avec un homme. Ce dernier louait des terrains et des locaux, et Marco connaissait donc personnellement certains des locataires de son petit ami. Un jour, en sortant les poubelles, il a été frappé et a perdu connaissance.
« En ouvrant la bouche, je me suis rendu compte que quelque chose de dur, comme du métal ou du plastique, en sortait. C’étaient mes dents », se souvient-il. Il a reconnu son agresseur comme étant un ami d’un locataire qu’il avait déjà vu à plusieurs reprises. L’homme a continué à le frapper à coups de pied, alors qu’il gisait au sol. Et quand le locataire lui-même a tenté de l’éloigner, il a crié : "Tu vois pas que c’est un Ouzbek pédé ?" Après cela, Marco est resté plusieurs jours à l’hôpital et a dit à son petit ami qu’il ne pouvait plus rester en Russie parce qu’il finirait par se faire tuer. Il s’est adressé à l’organisation Comité d’Assistance civique et, en 2013, avec l’aide de plusieurs organisations de défense des droits humains, il a obtenu le statut de réfugié aux États-Unis.
Marco est toujours en contact avec des amis ouzbeks : certains vivent en Russie, d’autres en Ouzbékistan. Les premiers disent que, ces dernières années, la vie en Russie s’est dégradée en raison de la montée de la xénophobie et de l’homophobie. Les seconds cherchent à emprunter de l’argent pour pouvoir s’installer en Russie. Quand Marco leur explique que la vie y sera difficile pour eux, ils répondent : "En Russie, où il y a beaucoup de gays, nous pourrons quand même survivre d’une manière ou d’une autre. Mais comment pouvons-nous survivre en Ouzbékistan ?" Ils espèrent qu’ils pourront rester en Russie et qu’ils y vivront en sécurité. Mais c’est une illusion : il est presque impossible de s’établir légalement en Russie et d’y obtenir le statut de réfugié. Et quand leurs papiers ne sont pas en règle, les migrants peuvent non seulement être arrêtés, mais aussi être expulsés vers leur pays d’origine, qu’ils ont fui pour échapper à ses lois répressives.
« En prison, le viol est employé comme une forme de torture à l’encontre des détenus politiques », explique-t-elle. « Après avoir subi un viol, ces hommes sont considérés comme des parias de la société. Leurs enfants ne pourront pas se marier : la makhalla (la communauté locale et ses représentants) ne viendra pas au mariage et ne soutiendra pas leur famille. »
Selon la militante des droits humains, les personnes LGBT victimes de violences sexuelles ne peuvent bénéficier d’aucune protection en Ouzbékistan, du fait de l’existence de l’article du code pénal criminalisant l’homosexualité et de l’homophobie ordinaire de la société ouzbèque. Et quand un membre de leur famille découvre ce qui leur est arrivé, ce sont les victimes qui sont considérées responsables des violences qu’elles ont subies.
D’après les informations récoltées par le Centre anti-discrimination Memorial, c'est au Turkménistan que des peines de prison pour homosexualité sont le plus souvent prononcées. En outre, les personnes condamnées pour cela sont souvent condamnées de nouveau, après leur libération, pour récidive. Derrière les barreaux, elles subissent des tortures et des violences sexuelles. À leur sortie de prison, elles n’ont pratiquement aucune chance de trouver un emploi normal et de s’adapter à la vie en société.
Les personnes LGBT ont peur de vivre dans un environnement aussi agressif et intolérant, et sont nombreuses à chercher un moyen de quitter le pays. Ataeva explique que plusieurs critères déterminent leur choix du pays de destination : la possibilité de s’y rendre sans visa, la maîtrise de la langue qui y est parlée et l’opportunité d’en partir ensuite vers un pays tiers, par exemple les États-Unis. C’est pourquoi les ressortissants d’Asie centrale partent dans leur très grande majorité en Russie, en Géorgie ou en Turquie – et avant la guerre, en Ukraine. La plupart de ceux qui choisissent la Russie comptent sur la taille immense du pays, croyant qu’ils pourront y vivre et y travailler sans qu’on les remarque particulièrement. Mais hélas pour eux, cette vision des choses est erronée.
Lorsque Marco est arrivé en Russie, il a senti qu’il pouvait se comporter plus librement : il s’est mis à prendre encore plus soin de lui et a acheté des jeans plus serrés que ceux qu’il pouvait se permettre de porter en Ouzbékistan. Il est tombé amoureux pour la première fois et a commencé à fréquenter un jeune homme. Au début, il a travaillé comme figurant dans des émissions télévisées et a dormi avec d’autres migrants dans des trains, des entrées d’immeuble et des sous-sols. Pendant cette période, il a été battu à plusieurs reprises par des adolescents et des jeunes hommes, qu’il décrit comme des skinheads. Un jour, rapporte-t-il, ses agresseurs l’ont emmené dans une forêt, l’ont frappé et lui ont uriné dessus.
« En Russie, j’ai ressenti le racisme chaque jour sans exception », dit Marco. « J’entre dans un magasin et j’entends des commentaires classiques du type : "Qu’est-ce qu’ils viennent foutre chez nous?", puis "Oh, voyez comme il est apprêté, comme il est parfumé. C’est peut-être un homosexuel ? Il n’avait probablement même pas de peigne dans son Tchourkistan [dénomination dégradante employée pour désigner les pays d’Asie centrale]". Et encore, ça, ce n’était pas grand-chose. Parfois, ils me frappaient. »
La goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Marco fut un incident survenu en 2012. À l’époque, il vivait à Obninsk avec un homme. Ce dernier louait des terrains et des locaux, et Marco connaissait donc personnellement certains des locataires de son petit ami. Un jour, en sortant les poubelles, il a été frappé et a perdu connaissance.
« En ouvrant la bouche, je me suis rendu compte que quelque chose de dur, comme du métal ou du plastique, en sortait. C’étaient mes dents », se souvient-il. Il a reconnu son agresseur comme étant un ami d’un locataire qu’il avait déjà vu à plusieurs reprises. L’homme a continué à le frapper à coups de pied, alors qu’il gisait au sol. Et quand le locataire lui-même a tenté de l’éloigner, il a crié : "Tu vois pas que c’est un Ouzbek pédé ?" Après cela, Marco est resté plusieurs jours à l’hôpital et a dit à son petit ami qu’il ne pouvait plus rester en Russie parce qu’il finirait par se faire tuer. Il s’est adressé à l’organisation Comité d’Assistance civique et, en 2013, avec l’aide de plusieurs organisations de défense des droits humains, il a obtenu le statut de réfugié aux États-Unis.
Marco est toujours en contact avec des amis ouzbeks : certains vivent en Russie, d’autres en Ouzbékistan. Les premiers disent que, ces dernières années, la vie en Russie s’est dégradée en raison de la montée de la xénophobie et de l’homophobie. Les seconds cherchent à emprunter de l’argent pour pouvoir s’installer en Russie. Quand Marco leur explique que la vie y sera difficile pour eux, ils répondent : "En Russie, où il y a beaucoup de gays, nous pourrons quand même survivre d’une manière ou d’une autre. Mais comment pouvons-nous survivre en Ouzbékistan ?" Ils espèrent qu’ils pourront rester en Russie et qu’ils y vivront en sécurité. Mais c’est une illusion : il est presque impossible de s’établir légalement en Russie et d’y obtenir le statut de réfugié. Et quand leurs papiers ne sont pas en règle, les migrants peuvent non seulement être arrêtés, mais aussi être expulsés vers leur pays d’origine, qu’ils ont fui pour échapper à ses lois répressives.
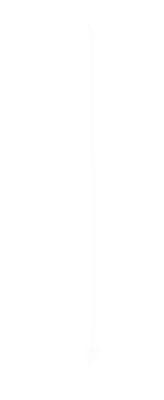
Fuir l’homophobie
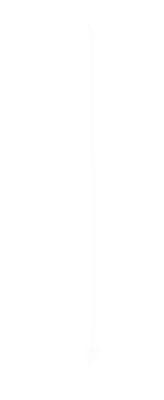
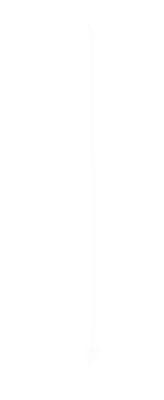

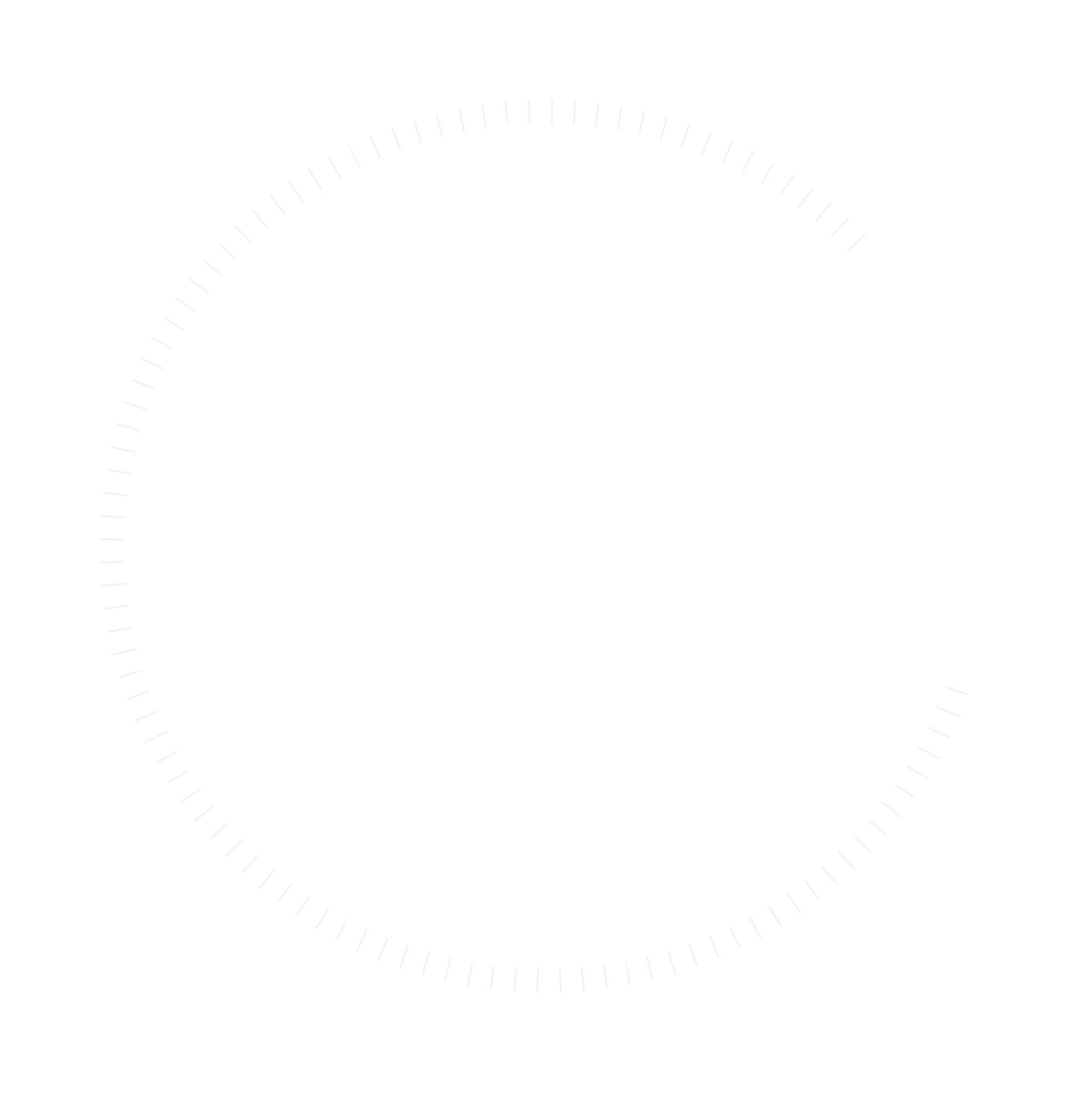
En 2017, le journaliste Ali Feruz, citoyen ouzbek, était sur le point d’être expulsé de Russie. Il a rapporté qu’en 2008, les services de sécurité ouzbeks avaient tenté de le recruter, après quoi il avait décidé de partir pour la Russie. Là, il a essayé pendant plusieurs années, en vain, d’obtenir le statut de réfugié et un asile temporaire. En conséquence, le 1er août 2017, il a été interpellé pour séjour irrégulier en Russie. Feruz a expliqué que s’il était renvoyé en Ouzbékistan, il serait persécuté pour des raisons politiques, détenu et torturé. Lorsqu’il s’est vu remettre le document l’informant que la décision avait été prise de l’expulser, il a fait une tentative de suicide, dans les locaux mêmes du tribunal. Il a ensuite passé six mois dans un centre de rétention des citoyens étrangers (CVSIG), et ce n’est que grâce à la publicité faite par les médias autour de son cas, et à l’intervention de la CEDH, de plusieurs personnalités publiques russes et de la médiatrice des droits humains Tatiana Moskalkova qu’il n’a pas été expulsé vers son pays d’origine, mais envoyé en Allemagne.
Très souvent, les nouveaux arrivants en Russie, comme Feruz, sont confrontés à l’impossibilité de devenir des réfugiés légaux, car l’État russe n’accorde ce statut à presque personne. En 2023, le nombre de demandes d’asile acceptées par la Russie a été historiquement bas : seules 16 requérants se sont vu accorder ce statut. À la fin de l’année 2023, le pays ne comptait que 244 réfugiés officiels. De fait, le maximum que les demandeurs peuvent espérer est l’asile temporaire. Ce statut n’est délivré que pour un an, il est difficile à prolonger et, contrairement au statut de réfugié, ses détenteurs ne peuvent pas bénéficier d’aides sociales. Toutefois, une personne ayant obtenu l’asile temporaire ne peut pas être expulsée et se voit accorder le droit de travailler. Mais ce statut aussi n’est octroyé que rarement. En 2023, l’« asile temporaire » n’a été accordé que 6 828 fois, soit 15 fois moins qu’en 2022. Par ailleurs, 80 % des personnes (5 435 exactement) qui l’ont obtenu en 2023 sont originaires d’Ukraine.
INFOGRAPHIE DONNÉES 1
Selon Stephania Koulaeva, experte au Centre anti-discrimination Memorial, la procédure d’obtention du statut de réfugié en Russie étant le plus souvent vouée à l’échec, les citoyens d’Asie centrale s'y essaient rarement et, pour l’essentiel, viennent en Russie en tant que travailleurs migrants. Cette tendance a été particulièrement marquée après les violences interethniques survenues au Kirghizistan en 2010 : en raison des attaques, des meurtres et des pillages que leur communauté y subissait, de nombreux Ouzbeks de souche qui vivaient dans ce pays ont été contraints de fuir pour la Russie. Au cours des années suivantes, la migration de travail est devenue pour eux « un substitut forcé au statut de réfugié ou à l’asile temporaire ».
Mais il y a aussi ceux qui demandent l’asile en Russie, même si leurs chances de l’obtenir sont minimes, parce qu’ils ne peuvent absolument pas retourner dans leur pays d’origine.
« Ce n’est pas comme si quelqu’un, à Tachkent, se disait : " Dans quel pays sûr, où on prendrait en compte la persécution dont je suis victime ici, pourrais-je aller ? Tiens, j’ai trouvé, je vais aller en Russie." Pas du tout. C’est une démarche contrainte. - explique Koulaeva. - Il arrive que des personnes se retrouvent en Russie et qu’elles ne puissent plus retourner chez elles. La seule raison permettant d’obtenir l’asile est la persécution politique que l’on subit dans son pays. Mais la Russie ne reconnaît pas l’existence de persécutions politiques à l’égard, par exemple, des musulmans radicaux ou des opposants au régime. Ces personnes savent qu’elles n’obtiendront pas l’asile, mais elles continuent à le demander, par désespoir. »
Des chercheurs du département de sciences politiques de l’université britannique d’Exeter ont créé en 2019 une base de données portant sur les migrants politiques originaires des pays d’Asie centrale. En 2020, cette base de données comptait 278 personnes. L’écrasante majorité d’entre elles étaient des réfugiés d’Ouzbékistan, le Tadjikistan arrivant en deuxième position. La liste comprend non seulement des personnes engagées en politique, mais aussi des journalistes, des militants des droits humains et des personnalités religieuses. Selon les créateurs de la base de données, la destination la plus fréquente des personnes persécutées est la Russie ; c’est aussi le pays qui procède le plus souvent à l’expulsion des demandeurs d’asile.
INFOGRAPHIE DONNÉES 2
Selon Stephania Koulaeva, les plus démunis sont les migrants qui se retrouvent dans les CVSIG, des lieux également appelés « centres d’expulsion ».
« Malheureusement, les journalistes russes n’avaient pas beaucoup parlé de ces CVSIG… jusqu’à ce que certains d’entre eux s’y retrouvent eux-mêmes. Quand les autorités russes se sont mises à condamner de nombreux journalistes pour diverses infractions administratives, les centres de détention temporaire ont rapidement été débordés, et des journalistes arrêtés ont alors été placés en détention dans des CVSIG. Ils ont été effarés en découvrant les effroyables conditions de vie dans ces centres. D’une certaine manière, on peut considérer que, pour eux, ce furent des "excursions" utiles : car les migrants ne restent pas là pendant 24 heures, comme ces journalistes, mais pendant des années, et il est important de le savoir et d’en parler », souligne Koulaeva.
Les conditions de vie dans les CVSIG sont quasi identiques à celles en vigueur dans les prisons : insalubrité, pas d’accès à l’eau potable, interdiction de sortir de la cellule, et les appels sur téléphone portable ne sont autorisés qu’à des moments strictement définis. Pour autant, un séjour en CVSIG n’est pas assimilé par la loi à l’exécution d’une peine. Formellement, il s’agit d’une « mesure provisoire » prise dans l’attente d’une décision d’expulsion. Les migrants se retrouvent en CVSIG pour des infractions administratives, telles que le dépassement de la durée autorisée de présence sur le territoire russe. Une fois qu’ils y sont, ils attendent une décision d’expulsion, mais cette attente peut être très longue.
En juin 2022, on a appris que des citoyens du Turkménistan se trouvaient depuis deux ans dans un tel centre de rétention de migrants près de Moscou. Ils y avaient été internés pour avoir dépassé la durée autorisée de séjour en Fédération de Russie après l’expiration de leur visa - mais en réalité, ils n’avaient pas pu partir à temps en raison de la pandémie de Covid-19, car les transports entre la Russie et le Turkménistan avaient été temporairement interrompus. Par conséquent, personne ne savait ce qu’il fallait faire d’eux, et ils ont été tout simplement été envoyés en CVSIG et y sont restés. Il arrive donc que des personnes soient placées dans ces centres pour des infractions mineures, mais qu’elles y passent au final plus de temps que certains détenus envoyés dans des colonies pour avoir commis de véritables crimes.
INFOGRAPHIE DONNÉES 4
En 2018, un ressortissant camerounais s’est retrouvé dans un centre de rétention en raison d’une erreur dans une décision de justice. En octobre de la même année, il avait été interpellé par des agents du service de contrôle de l’immigration du ministère de l’Intérieur et un protocole administratif avait été établi. Mais comme le Camerounais avait perdu ses papiers, son nom, dicté par l’inspecteur principal, avait été enregistré de manière erronée. Il s’est avéré que puisque le nom figurant dans la décision de justice étant différent du nom figurant dans le certificat de retour dans le pays d’origine délivré par l’ambassade, il était impossible de procéder à l’expulsion. La décision de justice a donc été annulée et le citoyen camerounais a été libéré. Cette procédure a duré un an et il a passé tout ce temps dans des conditions carcérales d’un CVSIG.
En décembre 2023, les défenseurs des droits humains ont réussi à faire adopter des amendements à la loi fédérale sur les infractions administratives : la loi russe stipule désormais que la durée de détention dans un CVSIG ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. À l’expiration de ce délai, un tribunal doit décider de prolonger la période de détention dans le centre ou de libérer la personne concernée. Le ministère de l’Intérieur peut demander une prolongation de la détention, et la personne peut demander son expulsion à ses propres frais ou sa libération. Si le système de contrôle judiciaire fonctionne correctement, les migrants (qu’ils prétendent ou non au statut de réfugié) n’auront plus à passer des mois ou des années dans un CVSIG sans espoir de sortie. Cela faisait dix ans que les défenseurs des droits humains réclamaient cet amendement.
Très souvent, les nouveaux arrivants en Russie, comme Feruz, sont confrontés à l’impossibilité de devenir des réfugiés légaux, car l’État russe n’accorde ce statut à presque personne. En 2023, le nombre de demandes d’asile acceptées par la Russie a été historiquement bas : seules 16 requérants se sont vu accorder ce statut. À la fin de l’année 2023, le pays ne comptait que 244 réfugiés officiels. De fait, le maximum que les demandeurs peuvent espérer est l’asile temporaire. Ce statut n’est délivré que pour un an, il est difficile à prolonger et, contrairement au statut de réfugié, ses détenteurs ne peuvent pas bénéficier d’aides sociales. Toutefois, une personne ayant obtenu l’asile temporaire ne peut pas être expulsée et se voit accorder le droit de travailler. Mais ce statut aussi n’est octroyé que rarement. En 2023, l’« asile temporaire » n’a été accordé que 6 828 fois, soit 15 fois moins qu’en 2022. Par ailleurs, 80 % des personnes (5 435 exactement) qui l’ont obtenu en 2023 sont originaires d’Ukraine.
INFOGRAPHIE DONNÉES 1
Selon Stephania Koulaeva, experte au Centre anti-discrimination Memorial, la procédure d’obtention du statut de réfugié en Russie étant le plus souvent vouée à l’échec, les citoyens d’Asie centrale s'y essaient rarement et, pour l’essentiel, viennent en Russie en tant que travailleurs migrants. Cette tendance a été particulièrement marquée après les violences interethniques survenues au Kirghizistan en 2010 : en raison des attaques, des meurtres et des pillages que leur communauté y subissait, de nombreux Ouzbeks de souche qui vivaient dans ce pays ont été contraints de fuir pour la Russie. Au cours des années suivantes, la migration de travail est devenue pour eux « un substitut forcé au statut de réfugié ou à l’asile temporaire ».
Mais il y a aussi ceux qui demandent l’asile en Russie, même si leurs chances de l’obtenir sont minimes, parce qu’ils ne peuvent absolument pas retourner dans leur pays d’origine.
« Ce n’est pas comme si quelqu’un, à Tachkent, se disait : " Dans quel pays sûr, où on prendrait en compte la persécution dont je suis victime ici, pourrais-je aller ? Tiens, j’ai trouvé, je vais aller en Russie." Pas du tout. C’est une démarche contrainte. - explique Koulaeva. - Il arrive que des personnes se retrouvent en Russie et qu’elles ne puissent plus retourner chez elles. La seule raison permettant d’obtenir l’asile est la persécution politique que l’on subit dans son pays. Mais la Russie ne reconnaît pas l’existence de persécutions politiques à l’égard, par exemple, des musulmans radicaux ou des opposants au régime. Ces personnes savent qu’elles n’obtiendront pas l’asile, mais elles continuent à le demander, par désespoir. »
Des chercheurs du département de sciences politiques de l’université britannique d’Exeter ont créé en 2019 une base de données portant sur les migrants politiques originaires des pays d’Asie centrale. En 2020, cette base de données comptait 278 personnes. L’écrasante majorité d’entre elles étaient des réfugiés d’Ouzbékistan, le Tadjikistan arrivant en deuxième position. La liste comprend non seulement des personnes engagées en politique, mais aussi des journalistes, des militants des droits humains et des personnalités religieuses. Selon les créateurs de la base de données, la destination la plus fréquente des personnes persécutées est la Russie ; c’est aussi le pays qui procède le plus souvent à l’expulsion des demandeurs d’asile.
INFOGRAPHIE DONNÉES 2
Selon Stephania Koulaeva, les plus démunis sont les migrants qui se retrouvent dans les CVSIG, des lieux également appelés « centres d’expulsion ».
« Malheureusement, les journalistes russes n’avaient pas beaucoup parlé de ces CVSIG… jusqu’à ce que certains d’entre eux s’y retrouvent eux-mêmes. Quand les autorités russes se sont mises à condamner de nombreux journalistes pour diverses infractions administratives, les centres de détention temporaire ont rapidement été débordés, et des journalistes arrêtés ont alors été placés en détention dans des CVSIG. Ils ont été effarés en découvrant les effroyables conditions de vie dans ces centres. D’une certaine manière, on peut considérer que, pour eux, ce furent des "excursions" utiles : car les migrants ne restent pas là pendant 24 heures, comme ces journalistes, mais pendant des années, et il est important de le savoir et d’en parler », souligne Koulaeva.
Les conditions de vie dans les CVSIG sont quasi identiques à celles en vigueur dans les prisons : insalubrité, pas d’accès à l’eau potable, interdiction de sortir de la cellule, et les appels sur téléphone portable ne sont autorisés qu’à des moments strictement définis. Pour autant, un séjour en CVSIG n’est pas assimilé par la loi à l’exécution d’une peine. Formellement, il s’agit d’une « mesure provisoire » prise dans l’attente d’une décision d’expulsion. Les migrants se retrouvent en CVSIG pour des infractions administratives, telles que le dépassement de la durée autorisée de présence sur le territoire russe. Une fois qu’ils y sont, ils attendent une décision d’expulsion, mais cette attente peut être très longue.
En juin 2022, on a appris que des citoyens du Turkménistan se trouvaient depuis deux ans dans un tel centre de rétention de migrants près de Moscou. Ils y avaient été internés pour avoir dépassé la durée autorisée de séjour en Fédération de Russie après l’expiration de leur visa - mais en réalité, ils n’avaient pas pu partir à temps en raison de la pandémie de Covid-19, car les transports entre la Russie et le Turkménistan avaient été temporairement interrompus. Par conséquent, personne ne savait ce qu’il fallait faire d’eux, et ils ont été tout simplement été envoyés en CVSIG et y sont restés. Il arrive donc que des personnes soient placées dans ces centres pour des infractions mineures, mais qu’elles y passent au final plus de temps que certains détenus envoyés dans des colonies pour avoir commis de véritables crimes.
INFOGRAPHIE DONNÉES 4
En 2018, un ressortissant camerounais s’est retrouvé dans un centre de rétention en raison d’une erreur dans une décision de justice. En octobre de la même année, il avait été interpellé par des agents du service de contrôle de l’immigration du ministère de l’Intérieur et un protocole administratif avait été établi. Mais comme le Camerounais avait perdu ses papiers, son nom, dicté par l’inspecteur principal, avait été enregistré de manière erronée. Il s’est avéré que puisque le nom figurant dans la décision de justice étant différent du nom figurant dans le certificat de retour dans le pays d’origine délivré par l’ambassade, il était impossible de procéder à l’expulsion. La décision de justice a donc été annulée et le citoyen camerounais a été libéré. Cette procédure a duré un an et il a passé tout ce temps dans des conditions carcérales d’un CVSIG.
En décembre 2023, les défenseurs des droits humains ont réussi à faire adopter des amendements à la loi fédérale sur les infractions administratives : la loi russe stipule désormais que la durée de détention dans un CVSIG ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. À l’expiration de ce délai, un tribunal doit décider de prolonger la période de détention dans le centre ou de libérer la personne concernée. Le ministère de l’Intérieur peut demander une prolongation de la détention, et la personne peut demander son expulsion à ses propres frais ou sa libération. Si le système de contrôle judiciaire fonctionne correctement, les migrants (qu’ils prétendent ou non au statut de réfugié) n’auront plus à passer des mois ou des années dans un CVSIG sans espoir de sortie. Cela faisait dix ans que les défenseurs des droits humains réclamaient cet amendement.
Pris au piège, sans statut de réfugié

Un système indifférent à tous
Le Com ité Assistance civique (GS) indique que, outre les citoyens d’Ukraine et d’Asie centrale, ce sont surtout les citoyens d’Afghanistan (ce sont les plus nombreux), de Syrie et de pays africains qui demandent l’asile en Russie.
« Les gens fuient les zones de guerre et de violences, - explique Anna (le prénom a été modifié), consultante chez GS. - Nous voyons arriver en Russie des réfugiés en provenance du Bangladesh dès qu’il y a des élections dans leur pays, parce qu’en période de campagne électorale le parti au pouvoir se met à exercer de fortes pressions sur ses concurrents, et cette situation engendre des réfugiés politiques. Nous avons aussi vu arriver de nombreux réfugiés en provenance du Soudan, du Yémen, de République démocratique du Congo et d’Irak. »
Selon Anna, les réfugiés originaires de ces pays choisissent la Russie parce qu’ils pensent que « c’est presque l’Europe, sauf qu’il est plus facile d’obtenir un visa ici ». Certains espèrent obtenir l’asile dans un autre pays en faisant la demande depuis le territoire de la Russie. Pour cela, la personne doit d’abord demander le statut de réfugié en Russie, passer par toutes les procédures bureaucratiques, puis, une fois qu’elle s’est vu opposer un refus, prouver au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qu’elle a réellement besoin de bénéficier d’une protection internationale et qu’elle ne peut pas retourner dans son pays d’origine. Dans ce cas, elle peut être envoyée dans un pays plus sûr. « Ce n’étaient que des cas isolés, mais il y avait au moins une chance de pouvoir partir ailleurs si l’on était rejeté partout et qu’il était vraiment dangereux de rentrer dans son pays, explique Anna. - Malheureusement, cela a pris fin parce que la Russie ne voulait plus être utilisée comme une sorte de tremplin pour les déplacements des migrants. »
Les arrivants d’Afrique et d’autres pays sont déçus par le fonctionnement du droit d’asile en Russie. Ils rencontrent des difficultés à toutes les étapes : en raison de la barrière de la langue, ils ne peuvent pas s’expliquer dans les institutions publiques, ils ne comprennent pas comment obtenir un enregistrement temporaire, sans lequel ils ne peuvent pas demander l’asile, ils ne savent pas comment rédiger des documents. Ils pensent que s’ils ont réussi à échapper à la guerre, ils seront volontiers aidés en Russie, mais lorsqu’ils arrivent, ils ne comprennent pas pourquoi ils n’obtiennent aucune aide. Bien sûr, ils sont également confrontés au racisme quotidien, mais certains ont la chance de rencontrer des personnes qui, loin de les discriminer, leur viennent au contraire en aide.
D’après les observations d’Anna, les dernières vagues de réfugiés n’espèrent plus obtenir l’asile ou la réinstallation dans un pays tiers. Mais certains pensent pouvoir fuir vers l’Ouest en passant par le Bélarus, et tentent de franchir la frontière illégalement. Ces tentatives sont parfois mortelles : des migrants venus du pays du sud, mal préparés, ont succombé au froid quand ils ont tenté cette périlleuse traversée en hiver. Certaines personnes décident d’émigrer au Bélarus parce qu’elles désespèrent d’obtenir un jour le statut de réfugié en Russie.
En 2014, Bozobeidou Batoma, un ancien membre de la garde présidentielle du Togo, s’est réfugié à Moscou. Dans son pays d’origine, il avait refusé d’exécuter l’ordre d’assassiner un dirigeant de l’opposition, ce qui lui avait valu d’être emprisonné et torturé. En Russie, il a tenté, cinq années durant, d’obtenir le statut de réfugié, survivant en multipliant les petits boulots occasionnels. Selon les souvenirs de la consultante de GS, il « devenait fou, il a fini par décider qu’il avait été trahi et oublié ». Il s’est rendu au Bélarus et y a demandé l’asile. Au bout de quelques mois, sa demande a été rejetée et il a été expulsé vers la Russie, placé dans un CVSIG, puis expulsé vers son pays d’origine, où il risque d’être condamné à mort.
En octobre 2023, on a appris que la Russie avait déporté au Turkménistan le religieux Ashirbaï Bekiev, qui avait été persécuté par les autorités de son pays pour dissidence. La Russie a d’abord émis un ordre d’extradition, qui a ensuite été annulé, mais Bekiev a finalement été expulsé après l’expiration de son passeport.
Les « réfugiés sur place » se sentent eux aussi abandonnés. Il s’agit de personnes qui, à l’origine, sont venues en Russie non pas pour y obtenir un statut de réfugié, mais pour d’autres raisons, par exemple pour faire leurs études. Mais en raison des conflits qui ont éclaté dans leur pays d’origine, elles ont été contraintes de rester en Russie et d’y demander l’asile. De nombreux citoyens afghans se sont retrouvés dans cette situation après l’arrivée au pouvoir des talibans au cours de l’été 2021.
Cherta a réussi à s’entretenir avec un citoyen afghan de 30 ans qui est venu étudier en Russie quelques mois seulement avant la prise de pouvoir des talibans. Il a expliqué, sous le couvert de l’anonymat, qu’il travaillait pour une agence gouvernementale afghane qui lui payait ses études à Moscou et lui versait une allocation lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, y compris de sa femme et de ses jeunes enfants. Mais après l’arrivée au pouvoir des talibans, il s’est retrouvé sans bourse ni contrat d’études. Grâce au Comité Assistance civique, il a réussi à obtenir un asile temporaire, mais il ne peut pas retourner en Afghanistan. Il est toujours en contact avec ses anciens collègues : ils lui disent qu’ils se cachent des talibans et qu’ils vivent dans la peur. Il se sent davantage en sécurité en Russie. Mais il ne peut ni poursuivre ses études ni trouver un emploi : il vit de petits boulots sur un chantier de construction, travaille comme serveur et éboueur.
Son rêve est de terminer ses études et d’obtenir un diplôme d’une université russe. En outre, depuis qu’il vit à Moscou, il s’est pris d’affection pour les Russes et ne veut donc pas partir. « Lorsqu’ils [les Russes] découvrent mes problèmes, ils essaient toujours de m’aider ou au moins de me soutenir moralement », a-t-il déclaré à Cherta. Il n’a pas vu ses parents, sa femme et ses enfants depuis trois ans.
Anna estime que le système en place en Russie n’aide pas spécialement les États autoritaires à récupérer leurs réfugiés politiques, mais qu’il n’aide pas non plus ceux qui se tournent vers lui. En fait, ce système est impitoyable par son indifférence : « Dans le cas du réfugié togolais, quelqu’un a-t-il voulu aider ce régime autoritaire ? Non, personne. On s’en balance, du Togo. On se balance de tout le monde. Je pense que le problème, ici, c’est l’indifférence et l’attitude consistant à ne laisser personne entrer [en Russie] ».
« Les gens fuient les zones de guerre et de violences, - explique Anna (le prénom a été modifié), consultante chez GS. - Nous voyons arriver en Russie des réfugiés en provenance du Bangladesh dès qu’il y a des élections dans leur pays, parce qu’en période de campagne électorale le parti au pouvoir se met à exercer de fortes pressions sur ses concurrents, et cette situation engendre des réfugiés politiques. Nous avons aussi vu arriver de nombreux réfugiés en provenance du Soudan, du Yémen, de République démocratique du Congo et d’Irak. »
Selon Anna, les réfugiés originaires de ces pays choisissent la Russie parce qu’ils pensent que « c’est presque l’Europe, sauf qu’il est plus facile d’obtenir un visa ici ». Certains espèrent obtenir l’asile dans un autre pays en faisant la demande depuis le territoire de la Russie. Pour cela, la personne doit d’abord demander le statut de réfugié en Russie, passer par toutes les procédures bureaucratiques, puis, une fois qu’elle s’est vu opposer un refus, prouver au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qu’elle a réellement besoin de bénéficier d’une protection internationale et qu’elle ne peut pas retourner dans son pays d’origine. Dans ce cas, elle peut être envoyée dans un pays plus sûr. « Ce n’étaient que des cas isolés, mais il y avait au moins une chance de pouvoir partir ailleurs si l’on était rejeté partout et qu’il était vraiment dangereux de rentrer dans son pays, explique Anna. - Malheureusement, cela a pris fin parce que la Russie ne voulait plus être utilisée comme une sorte de tremplin pour les déplacements des migrants. »
Les arrivants d’Afrique et d’autres pays sont déçus par le fonctionnement du droit d’asile en Russie. Ils rencontrent des difficultés à toutes les étapes : en raison de la barrière de la langue, ils ne peuvent pas s’expliquer dans les institutions publiques, ils ne comprennent pas comment obtenir un enregistrement temporaire, sans lequel ils ne peuvent pas demander l’asile, ils ne savent pas comment rédiger des documents. Ils pensent que s’ils ont réussi à échapper à la guerre, ils seront volontiers aidés en Russie, mais lorsqu’ils arrivent, ils ne comprennent pas pourquoi ils n’obtiennent aucune aide. Bien sûr, ils sont également confrontés au racisme quotidien, mais certains ont la chance de rencontrer des personnes qui, loin de les discriminer, leur viennent au contraire en aide.
D’après les observations d’Anna, les dernières vagues de réfugiés n’espèrent plus obtenir l’asile ou la réinstallation dans un pays tiers. Mais certains pensent pouvoir fuir vers l’Ouest en passant par le Bélarus, et tentent de franchir la frontière illégalement. Ces tentatives sont parfois mortelles : des migrants venus du pays du sud, mal préparés, ont succombé au froid quand ils ont tenté cette périlleuse traversée en hiver. Certaines personnes décident d’émigrer au Bélarus parce qu’elles désespèrent d’obtenir un jour le statut de réfugié en Russie.
En 2014, Bozobeidou Batoma, un ancien membre de la garde présidentielle du Togo, s’est réfugié à Moscou. Dans son pays d’origine, il avait refusé d’exécuter l’ordre d’assassiner un dirigeant de l’opposition, ce qui lui avait valu d’être emprisonné et torturé. En Russie, il a tenté, cinq années durant, d’obtenir le statut de réfugié, survivant en multipliant les petits boulots occasionnels. Selon les souvenirs de la consultante de GS, il « devenait fou, il a fini par décider qu’il avait été trahi et oublié ». Il s’est rendu au Bélarus et y a demandé l’asile. Au bout de quelques mois, sa demande a été rejetée et il a été expulsé vers la Russie, placé dans un CVSIG, puis expulsé vers son pays d’origine, où il risque d’être condamné à mort.
En octobre 2023, on a appris que la Russie avait déporté au Turkménistan le religieux Ashirbaï Bekiev, qui avait été persécuté par les autorités de son pays pour dissidence. La Russie a d’abord émis un ordre d’extradition, qui a ensuite été annulé, mais Bekiev a finalement été expulsé après l’expiration de son passeport.
Les « réfugiés sur place » se sentent eux aussi abandonnés. Il s’agit de personnes qui, à l’origine, sont venues en Russie non pas pour y obtenir un statut de réfugié, mais pour d’autres raisons, par exemple pour faire leurs études. Mais en raison des conflits qui ont éclaté dans leur pays d’origine, elles ont été contraintes de rester en Russie et d’y demander l’asile. De nombreux citoyens afghans se sont retrouvés dans cette situation après l’arrivée au pouvoir des talibans au cours de l’été 2021.
Cherta a réussi à s’entretenir avec un citoyen afghan de 30 ans qui est venu étudier en Russie quelques mois seulement avant la prise de pouvoir des talibans. Il a expliqué, sous le couvert de l’anonymat, qu’il travaillait pour une agence gouvernementale afghane qui lui payait ses études à Moscou et lui versait une allocation lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, y compris de sa femme et de ses jeunes enfants. Mais après l’arrivée au pouvoir des talibans, il s’est retrouvé sans bourse ni contrat d’études. Grâce au Comité Assistance civique, il a réussi à obtenir un asile temporaire, mais il ne peut pas retourner en Afghanistan. Il est toujours en contact avec ses anciens collègues : ils lui disent qu’ils se cachent des talibans et qu’ils vivent dans la peur. Il se sent davantage en sécurité en Russie. Mais il ne peut ni poursuivre ses études ni trouver un emploi : il vit de petits boulots sur un chantier de construction, travaille comme serveur et éboueur.
Son rêve est de terminer ses études et d’obtenir un diplôme d’une université russe. En outre, depuis qu’il vit à Moscou, il s’est pris d’affection pour les Russes et ne veut donc pas partir. « Lorsqu’ils [les Russes] découvrent mes problèmes, ils essaient toujours de m’aider ou au moins de me soutenir moralement », a-t-il déclaré à Cherta. Il n’a pas vu ses parents, sa femme et ses enfants depuis trois ans.
Anna estime que le système en place en Russie n’aide pas spécialement les États autoritaires à récupérer leurs réfugiés politiques, mais qu’il n’aide pas non plus ceux qui se tournent vers lui. En fait, ce système est impitoyable par son indifférence : « Dans le cas du réfugié togolais, quelqu’un a-t-il voulu aider ce régime autoritaire ? Non, personne. On s’en balance, du Togo. On se balance de tout le monde. Je pense que le problème, ici, c’est l’indifférence et l’attitude consistant à ne laisser personne entrer [en Russie] ».
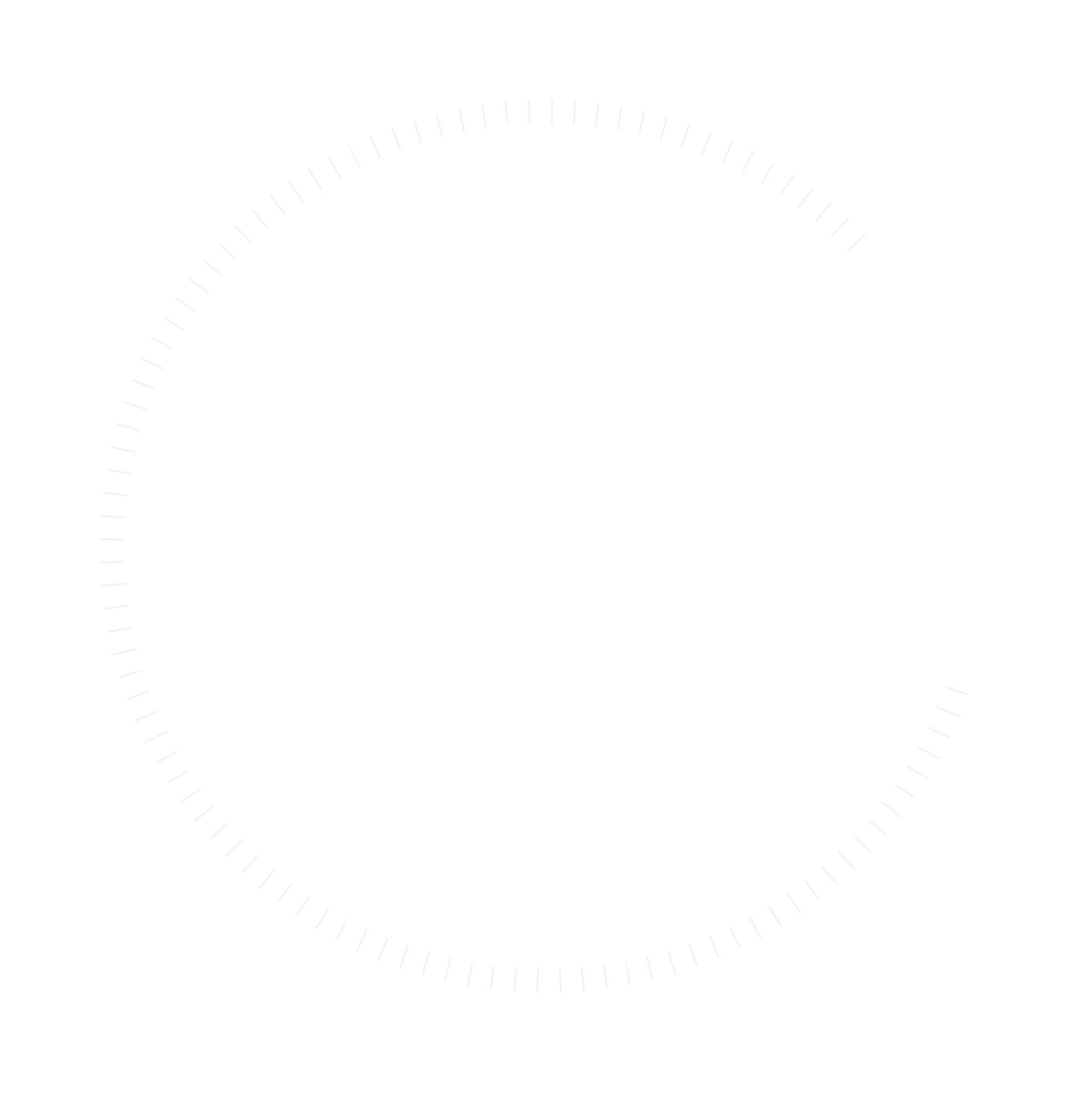
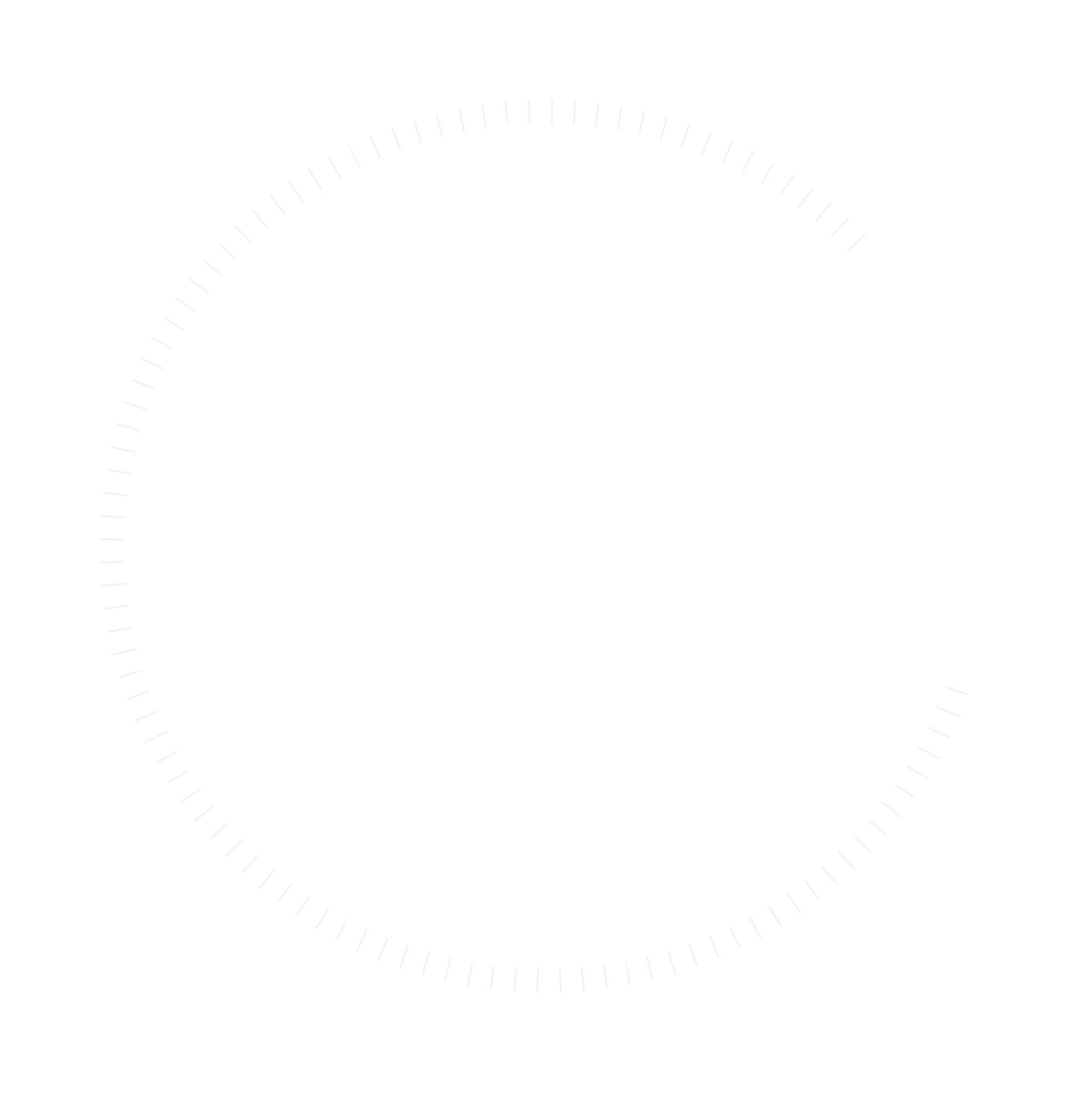

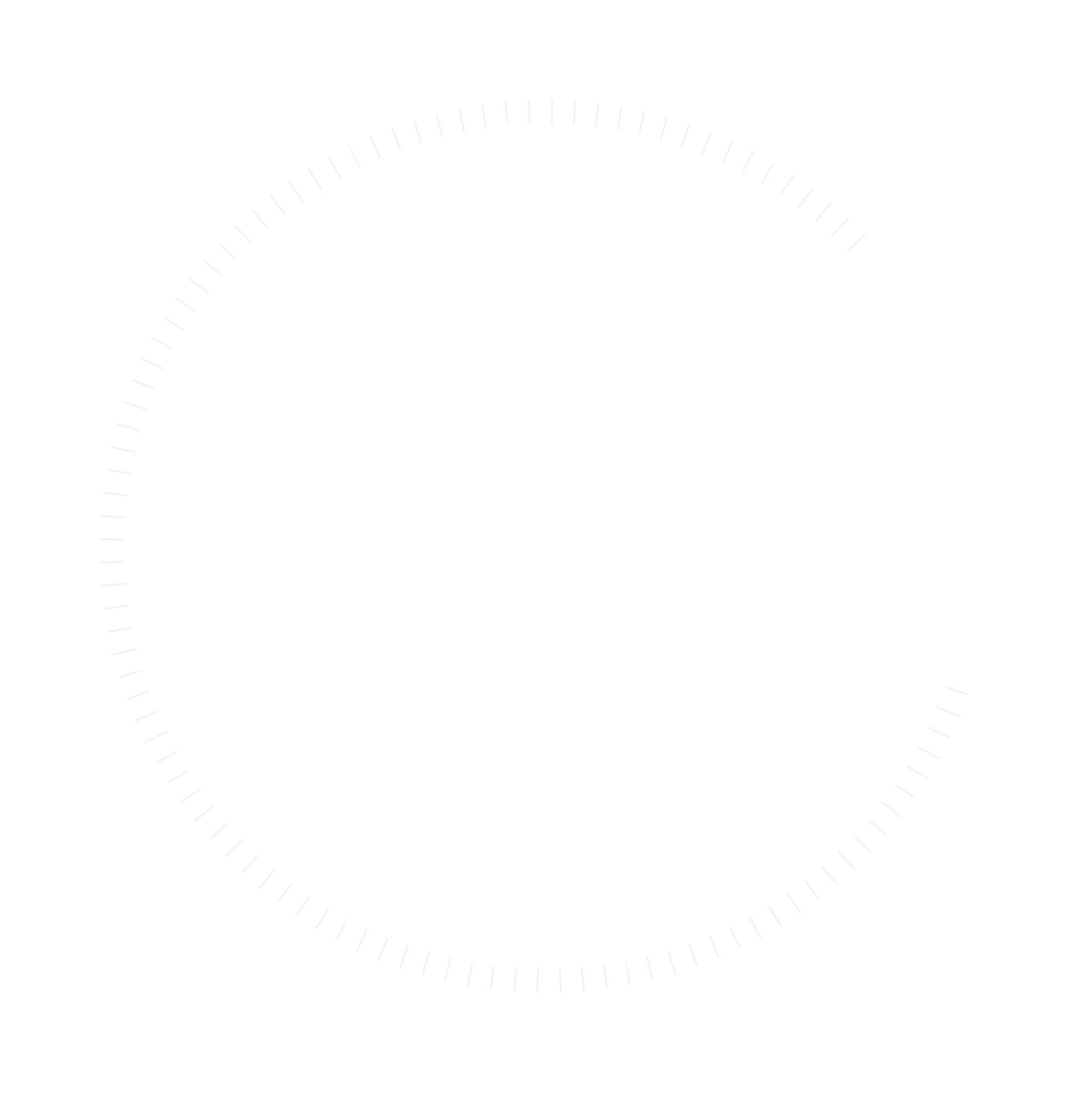
La situation des réfugiés et des migrants laissait déjà à désirer avant 2022. Mais après le déclenchement de la guerre en Ukraine, de nouveaux problèmes sont apparus. Le plus important est le recrutement de soldats pour la guerre. Des migrants d’Asie centrale ayant déjà obtenu la citoyenneté russe ont été menacés de se la voir retirer s’ils refusent d’aller au front. À l’inverse, des migrants apatrides se voient promettre la citoyenneté s'ils acceptent de rejoindre l'armée. En septembre 2022, la Douma d’État a adopté une loi selon laquelle les citoyens étrangers peuvent obtenir la citoyenneté russe s’ils signent un contrat de service militaire de trois ans.
En outre, les citoyens des républiques d’Asie centrale sont également attirés par le montant des soldes versées aux militaires sous contrat : le paiement minimum est de 210 000 roubles. On sait déjà que des citoyens du Tadjikistan, du Kirghizistan et du Kazakhstan combattent en Ukraine au sein de l’armée russe. On connaît également le cas d’un citoyen tadjik qui était détenu dans un CVSIG et qui, au lieu d’être expulsé, a été envoyé dans une unité militaire, puis au front.
Si un citoyen d’un pays combat sous contrat dans des guerres étrangères, cela est considéré comme du mercenariat. Au Tadjikistan et en Ouzbékistan, cette pratique est interdite par la loi. Presque immédiatement après le début de la guerre, les autorités ouzbèkes ont publié un avertissement indiquant que le mercenariat était un délit pénal.
Par ailleurs, selon Nadejda Ataeva, la présidente de l’association Droits de l’homme en Asie centrale, certains citoyens ouzbeks, y compris des dissidents, soutiennent sincèrement Vladimir Poutine.
« Même au sein de la communauté des droits humains, de nombreuses personnes soutiennent la politique de Poutine. Elles pensent encore que la Russie se bat seule contre l’Otan, etc. Elles écoutent Soloviev, elles succombent à la propagande russe. Les gens ont besoin de s’informer ; or les médias auxquels ils ont le plus facilement accès sont contrôlés par les autorités ouzbèques, et ces médias ne relaient que des informations pro-russes », souligne Ataeva.
Selon ses observations, les régimes politiques d’Asie centrale et leurs médias officiels sont depuis longtemps « sous l’emprise du Kremlin », si bien que la propagande russe est efficace dans ces républiques. Ainsi, Ozod, un Ouzbek de 35 ans qui a récemment obtenu la citoyenneté russe, a déclaré aux journalistes du média Cabar qu’il était prêt à aller au front parce que c’était son devoir. « Toute personne digne de ce nom devrait comprendre que si nous ne nous battons pas, nous serons en danger », a-t-il expliqué pour justifier sa décision. En janvier 2023, le chef du Comité d’enquête de la Fédération de Russie, Alexandre Bastrykine, a déclaré que la participation à la guerre était une obligation constitutionnelle pour les étrangers ayant obtenu un passeport russe.
L’experte du Centre anti-discrimination Memorial Stephania Koulaeva estime que les migrants sont activement incités à aller participer à la guerre en partie parce que, contrairement à la plupart des Russes, ils n’ont pas de parents en Russie qui pourraient publiquement exiger leur retour du front.
« Il s’agit d’un groupe non protégé, qui n’est pas soutenu par les autres segments de la population. En règle générale, ils n’ont pas de famille en Russie. Et [les autorités] n’aiment pas voir les épouses de soldats prendre la parole dans l’espace public pour demander le retour de leurs maris, de même qu’elles n’aiment pas les manifestations de souffrance et de mécontentement face aux pertes enregistrées par l’armée russe. Avec [les migrants], ces problèmes ne se posent pratiquement pas. Leurs épouses et leurs mères sont loin. Les autorités ont donc décidé qu’elles pouvaient facilement essayer de combler leur manque d’hommes en puisant dans le réservoir que constituent les migrants, même s’il s’agit de personnes totalement inadaptées au front. »
Selon les observations de Koulaeva, les agressions contre les ressortissants d’Asie centrale, en particulier les Tadjiks, se sont intensifiées au printemps 2023 après des raids des forces de l’ordre contre les migrants. À ce moment-là, les habitants de nombreuses régions russes se sont soudain mis à enregistrer des vidéos à l’intention des autorités locales affirmant que les nouveaux arrivants se comportaient de manière inappropriée, et la question de l’introduction de visas pour les personnes originaires d’Asie centrale est revenue à l’ordre du jour dans le débat public.
La situation des migrants LGBT s’est également détériorée depuis l’adoption de plusieurs lois répressives. Selon Ataeva, les réfugiés transgenres en Russie sont désormais pris au piège. En raison de la loi interdisant la transition transgenre, adoptée en juillet 2023, les nouveaux arrivants ne peuvent plus modifier leur passeport ou obtenir les fournitures médicales nécessaires, il leur est désormais impossible de rentrer chez eux, et la peur d’être contrôlés est devenue encore plus forte. Marco a expliqué à Cherta que sa petite amie transgenre, qui est restée en Russie, ne sort pratiquement plus de chez elle, car elle a peur de tomber sur des policiers.
Olga Baranova, directrice de projets du Centre communautaire de Moscou pour les initiatives LGBT+, a expliqué à Cherta que son Centre est parfois contacté par des migrants homosexuels. Ceux-ci sont confrontés à une double stigmatisation. Après le début de la guerre, leur sentiment d’oppression n’a fait que croître, et le nombre d’agressions signalées par ceux qui ont contacté le centre a augmenté.
« Il est très difficile pour ces personnes de survivre en Russie, où elles peuvent être battues dans la rue simplement parce qu’elles n’ont pas le bon aspect physique. Ce niveau de xénophobie, ce niveau d’agressivité dans la société augmente à cause de la guerre et c’est le groupe social le plus vulnérable qui en fait les frais, - explique Olga. - On ne voit pas à l’œil nu qu’un migrant d’Asie centrale est homosexuel, dès lors qu’il ne se comporte pas de manière stéréotypée. Quand ils sont passés à tabac, c’est avant tout parce qu’ils ont un type physique différent. Mais si les agresseurs considèrent que, en plus, leur victime est homosexuelle, alors le sort de celle-ci est encore pire. »
Lorsqu’on lui demande en quoi la vie des réfugiés s’est détériorée depuis le début de la guerre, Anna, la consultante du Comité Assistance civique répond succinctement : « Honnêtement, je ne sais pas comment la situation pourrait encore empirer. »
En outre, les citoyens des républiques d’Asie centrale sont également attirés par le montant des soldes versées aux militaires sous contrat : le paiement minimum est de 210 000 roubles. On sait déjà que des citoyens du Tadjikistan, du Kirghizistan et du Kazakhstan combattent en Ukraine au sein de l’armée russe. On connaît également le cas d’un citoyen tadjik qui était détenu dans un CVSIG et qui, au lieu d’être expulsé, a été envoyé dans une unité militaire, puis au front.
Si un citoyen d’un pays combat sous contrat dans des guerres étrangères, cela est considéré comme du mercenariat. Au Tadjikistan et en Ouzbékistan, cette pratique est interdite par la loi. Presque immédiatement après le début de la guerre, les autorités ouzbèkes ont publié un avertissement indiquant que le mercenariat était un délit pénal.
Par ailleurs, selon Nadejda Ataeva, la présidente de l’association Droits de l’homme en Asie centrale, certains citoyens ouzbeks, y compris des dissidents, soutiennent sincèrement Vladimir Poutine.
« Même au sein de la communauté des droits humains, de nombreuses personnes soutiennent la politique de Poutine. Elles pensent encore que la Russie se bat seule contre l’Otan, etc. Elles écoutent Soloviev, elles succombent à la propagande russe. Les gens ont besoin de s’informer ; or les médias auxquels ils ont le plus facilement accès sont contrôlés par les autorités ouzbèques, et ces médias ne relaient que des informations pro-russes », souligne Ataeva.
Selon ses observations, les régimes politiques d’Asie centrale et leurs médias officiels sont depuis longtemps « sous l’emprise du Kremlin », si bien que la propagande russe est efficace dans ces républiques. Ainsi, Ozod, un Ouzbek de 35 ans qui a récemment obtenu la citoyenneté russe, a déclaré aux journalistes du média Cabar qu’il était prêt à aller au front parce que c’était son devoir. « Toute personne digne de ce nom devrait comprendre que si nous ne nous battons pas, nous serons en danger », a-t-il expliqué pour justifier sa décision. En janvier 2023, le chef du Comité d’enquête de la Fédération de Russie, Alexandre Bastrykine, a déclaré que la participation à la guerre était une obligation constitutionnelle pour les étrangers ayant obtenu un passeport russe.
L’experte du Centre anti-discrimination Memorial Stephania Koulaeva estime que les migrants sont activement incités à aller participer à la guerre en partie parce que, contrairement à la plupart des Russes, ils n’ont pas de parents en Russie qui pourraient publiquement exiger leur retour du front.
« Il s’agit d’un groupe non protégé, qui n’est pas soutenu par les autres segments de la population. En règle générale, ils n’ont pas de famille en Russie. Et [les autorités] n’aiment pas voir les épouses de soldats prendre la parole dans l’espace public pour demander le retour de leurs maris, de même qu’elles n’aiment pas les manifestations de souffrance et de mécontentement face aux pertes enregistrées par l’armée russe. Avec [les migrants], ces problèmes ne se posent pratiquement pas. Leurs épouses et leurs mères sont loin. Les autorités ont donc décidé qu’elles pouvaient facilement essayer de combler leur manque d’hommes en puisant dans le réservoir que constituent les migrants, même s’il s’agit de personnes totalement inadaptées au front. »
Selon les observations de Koulaeva, les agressions contre les ressortissants d’Asie centrale, en particulier les Tadjiks, se sont intensifiées au printemps 2023 après des raids des forces de l’ordre contre les migrants. À ce moment-là, les habitants de nombreuses régions russes se sont soudain mis à enregistrer des vidéos à l’intention des autorités locales affirmant que les nouveaux arrivants se comportaient de manière inappropriée, et la question de l’introduction de visas pour les personnes originaires d’Asie centrale est revenue à l’ordre du jour dans le débat public.
La situation des migrants LGBT s’est également détériorée depuis l’adoption de plusieurs lois répressives. Selon Ataeva, les réfugiés transgenres en Russie sont désormais pris au piège. En raison de la loi interdisant la transition transgenre, adoptée en juillet 2023, les nouveaux arrivants ne peuvent plus modifier leur passeport ou obtenir les fournitures médicales nécessaires, il leur est désormais impossible de rentrer chez eux, et la peur d’être contrôlés est devenue encore plus forte. Marco a expliqué à Cherta que sa petite amie transgenre, qui est restée en Russie, ne sort pratiquement plus de chez elle, car elle a peur de tomber sur des policiers.
Olga Baranova, directrice de projets du Centre communautaire de Moscou pour les initiatives LGBT+, a expliqué à Cherta que son Centre est parfois contacté par des migrants homosexuels. Ceux-ci sont confrontés à une double stigmatisation. Après le début de la guerre, leur sentiment d’oppression n’a fait que croître, et le nombre d’agressions signalées par ceux qui ont contacté le centre a augmenté.
« Il est très difficile pour ces personnes de survivre en Russie, où elles peuvent être battues dans la rue simplement parce qu’elles n’ont pas le bon aspect physique. Ce niveau de xénophobie, ce niveau d’agressivité dans la société augmente à cause de la guerre et c’est le groupe social le plus vulnérable qui en fait les frais, - explique Olga. - On ne voit pas à l’œil nu qu’un migrant d’Asie centrale est homosexuel, dès lors qu’il ne se comporte pas de manière stéréotypée. Quand ils sont passés à tabac, c’est avant tout parce qu’ils ont un type physique différent. Mais si les agresseurs considèrent que, en plus, leur victime est homosexuelle, alors le sort de celle-ci est encore pire. »
Lorsqu’on lui demande en quoi la vie des réfugiés s’est détériorée depuis le début de la guerre, Anna, la consultante du Comité Assistance civique répond succinctement : « Honnêtement, je ne sais pas comment la situation pourrait encore empirer. »
La situation ne peut plus empirer